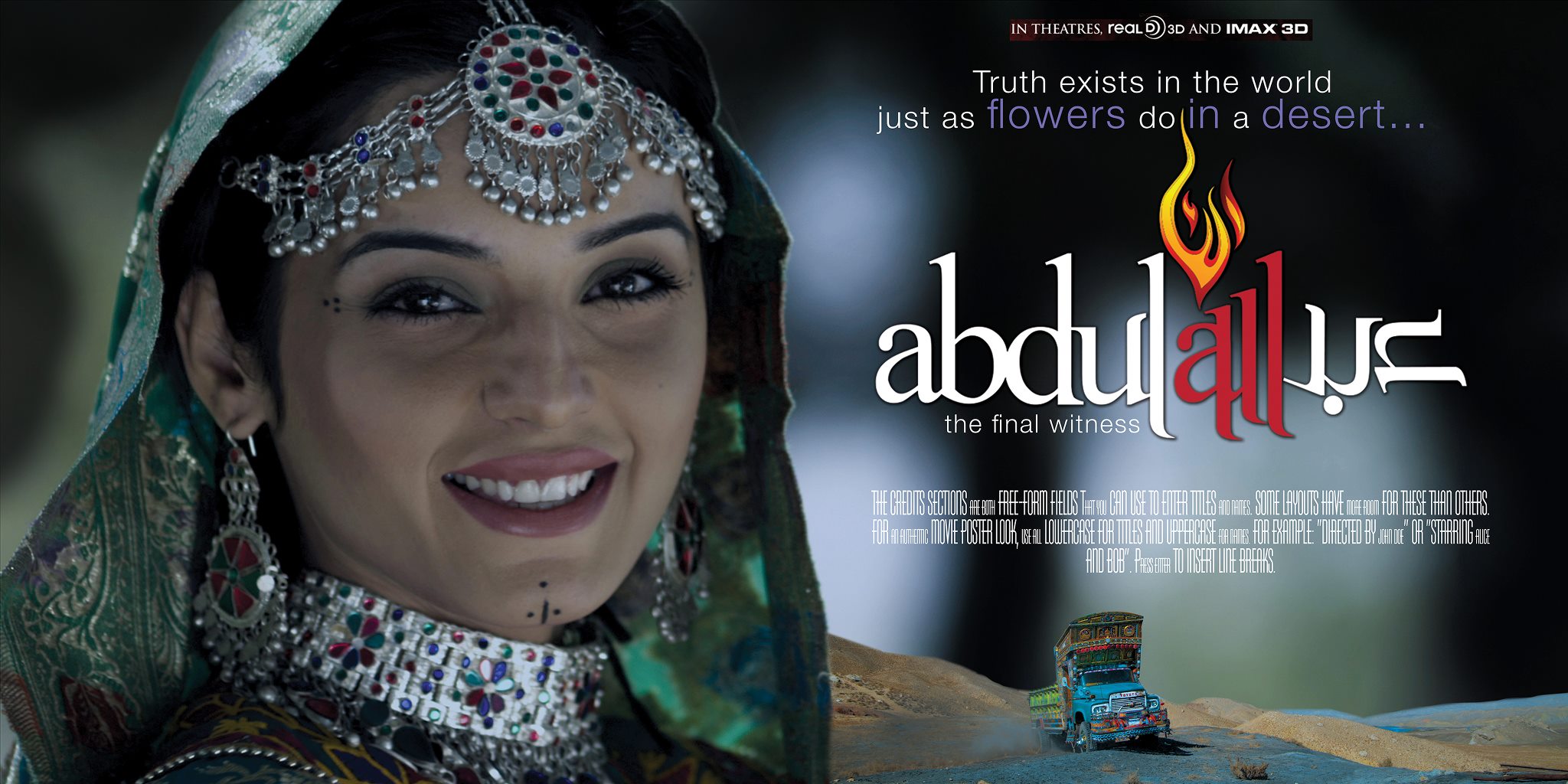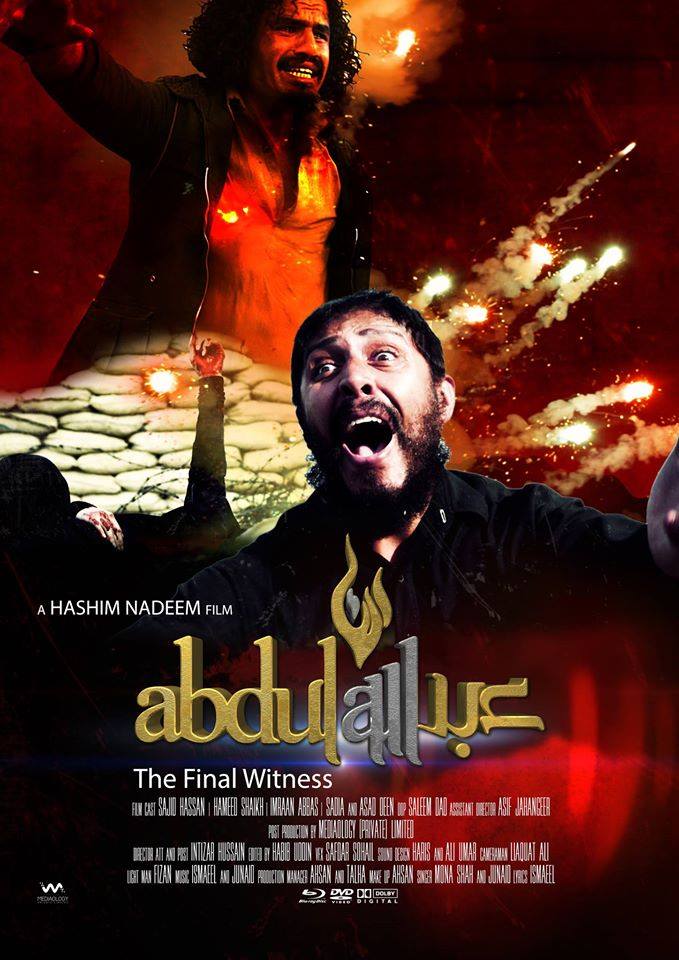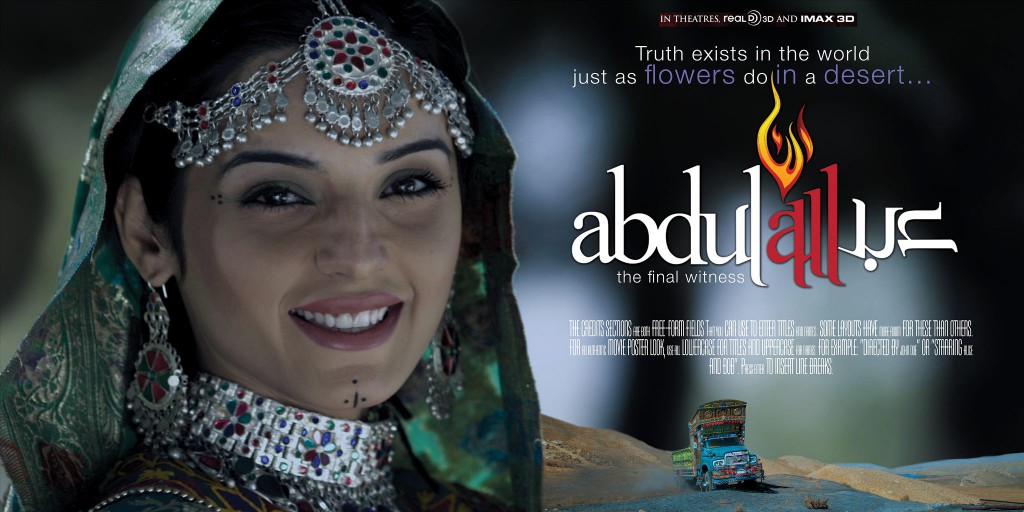Auréolé de mystère et précédé d’une réputation plus que flatteuse, The Son of Saul de Laszlo Nemes se présente comme le film de tous les défis. Un réalisateur hongrois en compétition officielle dès son premier film, c’est une première dans l’histoire du festival : attention film-événement donc. Un sujet plus que lourd, et qui à la suite de Shoah de Claude Lanzmann pose la question de ce qui, dans la solution finale, peut être ou non représenté. Il faut reconnaître à Laszlo Nemes le courage de répondre à sa façon à cette question, et de reprendre le débat là où, en somme, Steven Spielberg l’avait laissé avec La Liste de Schindler. Mais justement, c’est sa réponse qui pose problème. Car, s’il est convaincant sur certains aspects, il l’est beaucoup moins sur d’autres.
Saul fait partie des fameux Sonderkommandos des camps de la mort : à part des autres prisonniers juifs, ceux qui forment ces bataillons ont l’atroce devoir d’assister les nazis dans leur travail d’extermination. Préparation des chambres à gaz, transport des milliers de cadavres, préparation des fours crématoires, recueil et élimination des cendres. Dès les premières images du film, nous sommes plongés au cœur de l’enfer concentrationnaire. Cette situation va donner à Laszlo Nemes l’argument de son scénario : en faisant l’inventaire des corps, Saul croit reconnaître celui de son fils. S’engage alors une course contre la montre pour faire échapper le cadavre enfantin au crématoire et lui offrir une inhumation selon le rite.
La première force du film émane directement de cette incroyable idée. D’autant qu’elle est très finement et intelligemment mise en scène : tout au long du film perdure une ambiguïté, car on ne saura jamais, au fond, si le petit cadavre est vraiment celui du fils de Saul. Cette ambiguïté tient en elle tout le propos du film. Car le cadavre que Saul essaie de « sauver » du crématoire est évidemment une allégorie : si ce n’est pas forcément le fils de Saul c’est, plus largement, le fils de l’homme. Laszlo Nemes fait ainsi comprendre, par un très intelligent parcours, ce qu’est un crime contre l’humanité : car tout ce que Saul manifeste pour le petit cadavre représente la seule humanité présente dans le lager. Nemes filme avec soin les transports du cadavre, que Saul dépose sur des oreillers, avec délicatesse, là où les autres corps sont jetés et blessés sans hésitation. Le souci de l’autre, voici ce qui définit l’humanité, et en creux cette horreur absolue qu’est le crime contre l’humanité. Ce fils de l’humanité tout entière mérite qu’on l’entoure, qu’on l’emmène, qu’on le considère tout simplement. Le propos est magnifique, et le scénario qui le met en scène remarquable.
En revanche, la mise en images de cette lutte pour la dignité d’un cadavre pose un certain nombre de difficultés. Heureusement, Laszlo Nemes ne tombe pas dans le piège spielbergien : le recours au format 4/3 empêche la contemplation panoramique, donc l’esthétisation excessive de l’horreur. Le refus du cinémascope permet d’empêcher la caméra de jouir de ce qu’elle filme, et le spectateur de profiter du spectacle. De plus, la caméra à l’épaule, jamais à plus d’un mètre du personnage, collée à ses moindres déplacements, états d’âme, émotions, évite de s’appesantir sur le cadre, dont nous ne verrons pas grand chose : pas de plans à distance sur les camps, sur les douches, sur les crématoires. Seulement des corps, jamais montrés dans leur intégralité.
Pourtant, une sensation de gêne s’installe assez vite. Car à mesure qu’avance le scénario, le pathos prend peu à peu le dessus sur la « bonne distance », et la course contre la montre devient un film d’aventures dérangeant. Nemes fait une confiance excessive au visage, et surtout aux yeux de son acteur Geza Röhrig, qui surjoue certaines situations. Quant à la scène finale, elle ruine hélas les efforts du réalisateur en faisant jouer à l’acteur un sourire franchement déplacé lorsqu’un enfant paraît. Le film tombe alors, si ce n’est dans le ridicule, du moins dans la naïveté, comme s’il fallait à tout prix mettre une note d’espoir là où l’on sait pourtant que les ténèbres l’emportent. L’émotion facile clôt alors le film. Dommage. Erreur de jeunesse peut-être.
Nombre des spectateurs sortant de la projection officielle de The Son of Saul ont crié au génie. On peut leur donner raison, on l’a dit, sur quelques points. Mais, à lire la presse (notamment américaine), à entendre les critiques qui s’expriment dans les files d’attente, on se demande si le film de Laszlo Nemes n’est pas en train de commettre un hold-up sur la compétition officielle, par la seule force de son sujet. Car dans les allées cannoises, il semble presque interdit de dire du mal de The Son of Saul, qui n’est pourtant pas sans défaut. Comme si la lourdeur du sujet imposait la « palmabilité », comme on l’a vécu en 2004 avec l’attribution contestable de la récompense suprême à Michael Moore. Il serait bon que le jury évalue une manière plus qu’un sujet. Et pourtant, il se murmure que The Son of Saul pourrait tout rafler. Ce serait consensuel. Mais ce serait une erreur.
Jocelyn Maixent