La thématique était périlleuse : une jeune femme accidentée, le handicap, un type un peu paumé qui vient s’installer chez sa sœur au bord de la mer et qui traîne son gamin, l’inévitable histoire d’amour ; deux estropiés en quête d’attention, le mélo typique, en somme. C’était sans compter sur la patte incroyable d’Audiard.
Avant l’histoire d’amour, c’est une histoire de rencontres qui nous est montrée. Une histoire de confrontations ; ce sont des vies qui s’entrechoquent, des corps qui se heurtent, c’est la masse imposante, étouffante de l’orque qui nous écrase de son immensité et qui ôte ses jambes à Stéphanie. C’est cet enfant qui quête le regard de son père et qui n’en tire qu’un agacement non dissimulé, ce sont ces gestes maladroits, cette façon d’être en décalage. C’est l’âpreté de l’existence, la vie brute, sans artifice.
Caméra à l’épaule, Jacques Audiard filme le mouvement et à travers lui, la lumière. Un éclat ténu mais permanent ; le réalisateur joue avec les ombres et même quand ses personnages semblent fixer l’obscurité, la lumière est là, elle résiste, comme le symbole d’une fougue prête à exploser. On retrouve cette fébrilité chez Ali (Matthias Schoenaerts) et Stéphanie (Marion Cotillard). Ils ont en commun une sensibilité à fleur de peau, qui s’exprime par le combat chez lui – ce besoin irrépressible de se lever, de cogner, de courir – et par la réappropriation de son corps à elle, dans la nage, la rééducation, dans les bouffées d’impuissance, dans les cris. Audiard filme au plus près des visages et des corps, les rendant fragiles et imparfaits.
Plus que jamais, le corps est mis en exergue ; le sexe est filmé nu, on pénètre dans l’intimité sans pudeur mais avec retenue, les corps s’enroulent, se lient. Audiard ne cache pas l’infirmité, il la montre brute, les moignons bien apparents mais il n’y a pas de malaise, il n’y a que la sensualité ébouriffante de Marion Cotillard et le regard de Matthias Schoenaerts sur elle. Son regard d’homme sur un corps de femme, comme une évidence. Point de handicap quand il s’agit de faire l’amour, juste la rencontre ; et le plaisir.
Audiard n’embellit pas la vie, il ne tombe pas dans le superflu. Il choisit de faire l’économie des mots ; tout passe par l’image, par les expressions sur les visages abîmés des personnages – tout aussi bien les secondaires que les héros, d’ailleurs. Le bruit de la bande son n’est pas nettoyé et la vie s’infiltre partout, tout le temps. En exergue, en arrière-plan, dans le cadre mais aussi hors champ et c’est ça qui provoque l’émotion. L’alternance entre silences et bruits. Entre immobilisme et mouvement. Quand Stéphanie retourne se baigner pour la première fois après l’accident et sort de l’eau sur les épaules d’Ali, elle a la chair de poule, les larmes aux yeux. On sent dans cette femme qui s’abandonne la fatigue physique de la nageuse, mais aussi la satisfaction inestimable de la redécouverte d’un plaisir qu’elle croyait oublié ; une émotion exacerbée par une Marion Cotillard solaire.
C’est un film vrai, entier et pourtant tout en subtilité, un film où l’émotion n’est pas facile mais bien présente. Un film de qualité, à peine terni par la tirade de Stéphanie sur la délicatesse – trop mièvre – et la scène finale, consensuelle, qui entraîne Audiard dans la sensiblerie qu’il avait jusqu’à alors merveilleusement évitée.
Mais ces exceptions sont infimes et le réalisateur sait nous conter une histoire d’humanité et d’humilité sans tomber dans le lyrisme. Une histoire de vie qui frappe et caresse dans le même temps. Et face à cette vie si infiniment fragile et douloureuse, il y a le regard de l’enfant, qui scrute le monde ; deux grands yeux qui brillent de curiosité, d’insolence, de désir. D’amour. Et sur son visage, irradiante, la lumière.
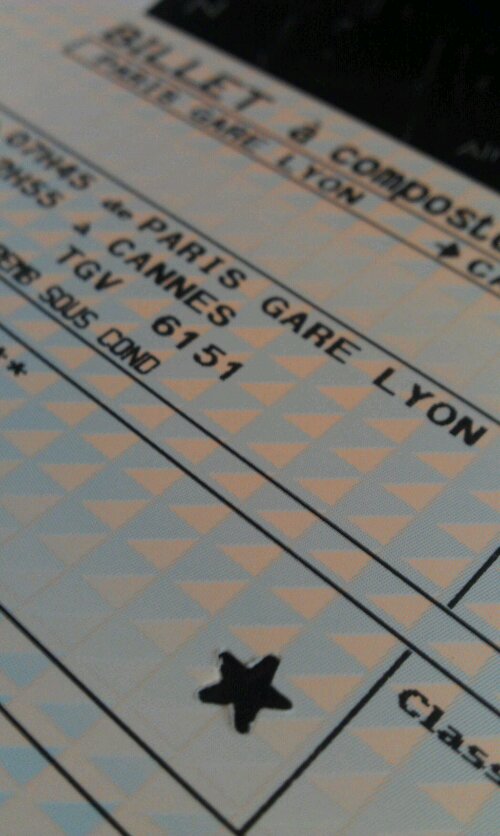

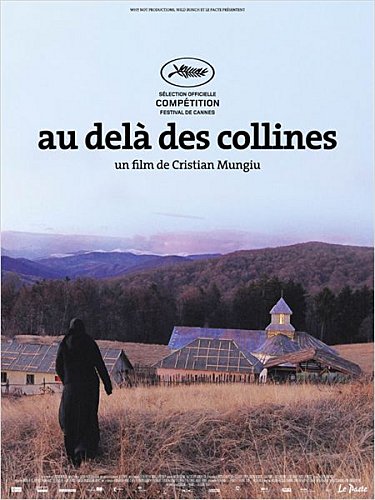
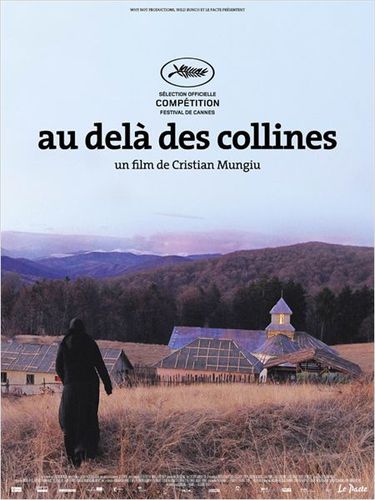 recourents dans les critiques semblent être „exorcisme” et „mort”. Pour le spectateur sensible, la réponse est OUI, cela arrive, le film est inspiré d’une histoire vraie, marqué bien sûr par la touche d’un grand réalisateur. On est clairement pressés de voir (et revoir, et revoir) ce film pour réussir à élargir notre perspective et, comme Mungiu lui-même veut, créer une polémique.
recourents dans les critiques semblent être „exorcisme” et „mort”. Pour le spectateur sensible, la réponse est OUI, cela arrive, le film est inspiré d’une histoire vraie, marqué bien sûr par la touche d’un grand réalisateur. On est clairement pressés de voir (et revoir, et revoir) ce film pour réussir à élargir notre perspective et, comme Mungiu lui-même veut, créer une polémique.

