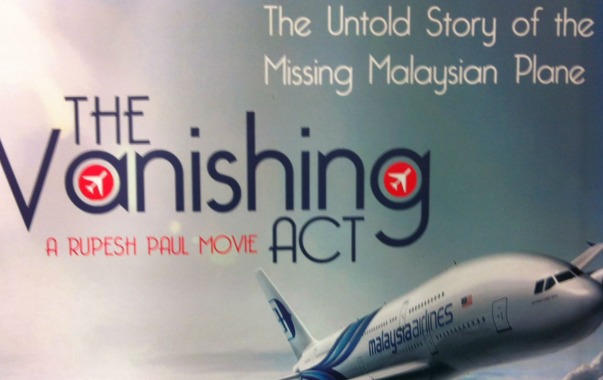C’est la première fois que Xavier Dolan concourt pour la Palme d’or. Cinquième long-métrage du jeune réalisateur, « Mommy » présenté en compétition semble faire l’unanimité sur la Croisette.

L’histoire se base sur la relation houleuse entre une mère et un fils, un adolescent impulsif et violent atteint de TDAH – Trouble Déficit de l’Attention Hyperactivité. A l’aide de la voisine, Kyla, ils recherchent une forme d’équilibre et d’espoir.
Le film est bouleversant, en grande partie grâce au jeu des acteurs. L’adolescent interprété par Antoine-Olivier Pilon est une véritable révélation. Son personnage déstabilise aussi bien qu’il fascine. Face à lui, Anne Dorval incarne à merveille sa mère, fragile et imprévisible, au langage charretier. Suzanne Clément joue la troisième figure, celle de la voisine un peu mal dans sa peau, qui tente d’adoucir à la fois cette opposition et cette union. Xavier Dolan cherche à parler de sujet qu’il maîtrise, une des clés de son succès. Une histoire inspirée de la figure maternelle, avec une sorte de fascination.
La justesse de la réalisation permet aux spectateurs de s’immerger totalement dans la peau des personnages. L’interprétation et l’appropriation de l’histoire reste libre. L’histoire sombre transporte dans un univers de tensions et d’émotions, mélangeant scènes conflictuelles et de réconciliations. De plus, l’originalité réside dans le format de l’écran, une belle surprise. La bande son constitue un élément majeur de cette réussite aussi bien esthétique que technique. Lien entre les scènes, elle reflète très justement les émotions des personnages.
« Mommy » est donc promis à un beau succès samedi soir.
Camille Bour