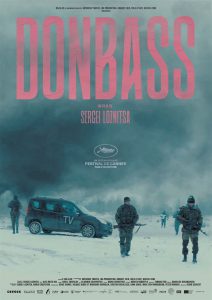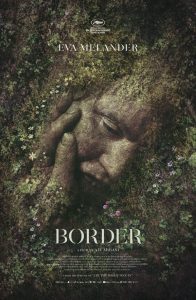Un Couteau dans le Cœur était l’un des films les plus attendus de cette soixante et onzième édition du Festival de Cannes. En liste pour la Palme d’Or, le nouveau film de Yann Gonzales fait désormais beaucoup parler de lui dans la presse. Les critiques sont mitigées, souvent très bonnes ou très mauvaises. Il s’agit seulement du deuxième long métrage du réalisateur après Les Rencontres d’après Minuit, déjà salué par le Festival de Cannes en 2013. Son premier film avait, en effet, remporté le prix de la Caméra d’Or.
Yann Gonzales revient donc avec une nouvelle production qui immerge le lecteur dans le monde du porno gay. Le rôle principal fut attribué à Vanessa Paradis, éblouissante sur le tapis rouge dans sa robe argentée. Elle incarne une productrice de porno gay, alcoolique et audacieuse qui se retrouve confrontée à une rupture amoureuse avec Loïs, la responsable du montage de son équipe. S’ajoute à ses tourments sentimentaux et à la pression de sa nouvelle création, l’ouverture d’une enquête suite à la mort particulièrement sordide de plusieurs acteurs présents dans ses films. Ce thriller psychologique vacille entre humour noir, scènes crues et osées, questionnant ainsi les systèmes de normes et les marges culturelles. On retrouve notamment dans Un Couteau dans le Cœur, une remise en question du caractère figé des identités sexuelles. L’esthétique du film et son ambiance psychédélique sont également remarquables.
L’intrigue est bien ficelée et pleine de suspens, les acteurs admirables. On notera, en particulier, la belle performance de l’acteur Nicolas Maury, incarnant l’acolyte de la productrice. Ce film est, en somme, une belle découverte. Les avis négatifs semblent, toutefois, avoir pris le dessus car Un Couteau dans le Cœur n’a reçu aucun prix lors de la grande cérémonie de clôture du festival, la Palme d’Or ayant été attribuée au film Affaire de famille du réalisateur japonais Hirozaku Kore-eda.