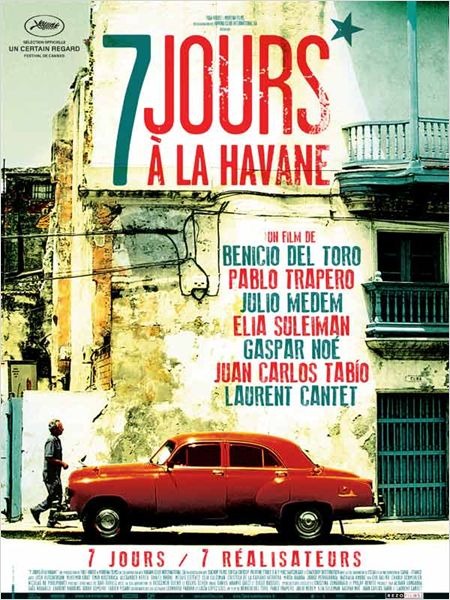C’est parfois difficile de parler aux gens que l’on aime. Difficile de faire le point sur les bonnes et mauvaises actions de sa vie, et de savoir que, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. « Quelques heures de Printemps » est l’histoire d’une relation mère-fils dont on ne connait pas le passé mais qui est chargé, on le devine. Chacun chargé d’un fardeau et après plusieurs mois, ils se retrouvent : Yvette (Hélène Vincent) a un cancer, et a décidé de planifier sa mort. Alain (Vincent Lindon), le fils tout juste sorti de prison, retourne vivre chez sa mère pour tenter de se reconstruire.
Lien
Le loup dort derrière les repas silencieux, les regards qui s’évitent, les banalités du quotidien. Entre la mère et le fils, il y a un volcan qui menace à chaque seconde de s’activer. Ce qui les rassemblent : le chien d’Yvette, et son voisin Monsieur Lalouette (Olivier Perrier), deux êtres aimés par la mère et le fils. Vincent Lindon, c’est ce grand cœur qui souffre. Seule alternative : l’agressivité, les mots durs qui achèvent sa mère, elle qui ne saura jamais lui parler d’autre chose que de son manque de savoir-vivre et ses erreurs du passé. Alain ne sait pas parler non plus. Derrière leurs « caractères de con », la conscience d’avoir échouer. Alors Alain se contentera d’accompagner sa mère au bout de la vie, parce que c’est déjà ça. Elle ne lui demande pas mais n’attend que ça. Il aura toujours ce regard triste, ni aimant, ni haineux, juste résigné. Ce n’est certainement pas lui qui pèsera sur les choix de vie de sa mère, il n’essaie même pas. Il sait juste qu’il doit être là. Non pas parce qu’il comprend, ou parce qu’il a oublié le passé, mais juste parce que c’est sa mère, et qu’il l’aime, incontestablement, tout comme elle l’aime. Le passé, aucun flash-back pathos et boiteux ne le fera découvrir au spectateur. On ne rejoue pas les malheureux épisodes d’une vie de famille, on n’essaie pas de trouver des excuses. Stéphane Brizé a choisi le moment d’une vie, celui qui n’efface pas les blessures mais qui compte plus que tout à cet instant précis.
« Jusqu’à la dernière minute vous pouvez changer d’avis »
« Quelques heures de Printemps », c’est aussi un positionnement très affirmé sur l’euthanasie. Hélène doit aller en Suisse pour pouvoir mourir. Les personnes qui l’accompagnent dans sa démarche lui demandent à nouveau ses « motivations », la questionnent sur ses croyances, tentent d’ouvrir la brèche qui lui fera faire marche arrière : « Jusqu’à la dernière minute, vous pouvez changer d’avis » lui précise-t-on. Mais si les sanglots d’Hélène traversent les murs de la chambre de son fils, elle est sûre de ses choix. Les magnifiques montagnes suisses sous l’œil de Stéphane Brizé, Vincent Lindon conduit alors sa mère vers la mort qui a belle allure. Ce n’est que dans les dernières secondes que mère et fils tomberont dans les bras l’un de l’autre pour une étreinte faite de tremblements et d’un ultime message d’amour. Le premier et le dernier.
Vieux
La population est vieillissante. On ne l’entend que trop. Il y a là pour les cinéastes une source d’inspiration qui a été largement récompensée à Cannes : « Quelques heures de Printemps » n’est en effet pas sans nous rappeler « Amour », la palme d’or 2012. Michael Haneke abordait les thèmes de la vieillesse et de la mort, avec des plans d’une simplicité déconcertante, ceux qui montrent la vie, et l’amour. Devant le film de Stéphane Brizé, armez-vous de mouchoirs et prenez cette claque déconcertante. Saluez le jeu si juste de Vincent Lindon et d’Hélène Vincent. L’acoustique parfaite des non-dits, de cet on-ne-sait-quoi qui brise la gorge et empêche l’amour de s’exprimer. Et dans un peu moins d’un mois, si vous avez aimé « Quelques heures de Printemps », ne manquez « Amour » sous aucun prétexte.